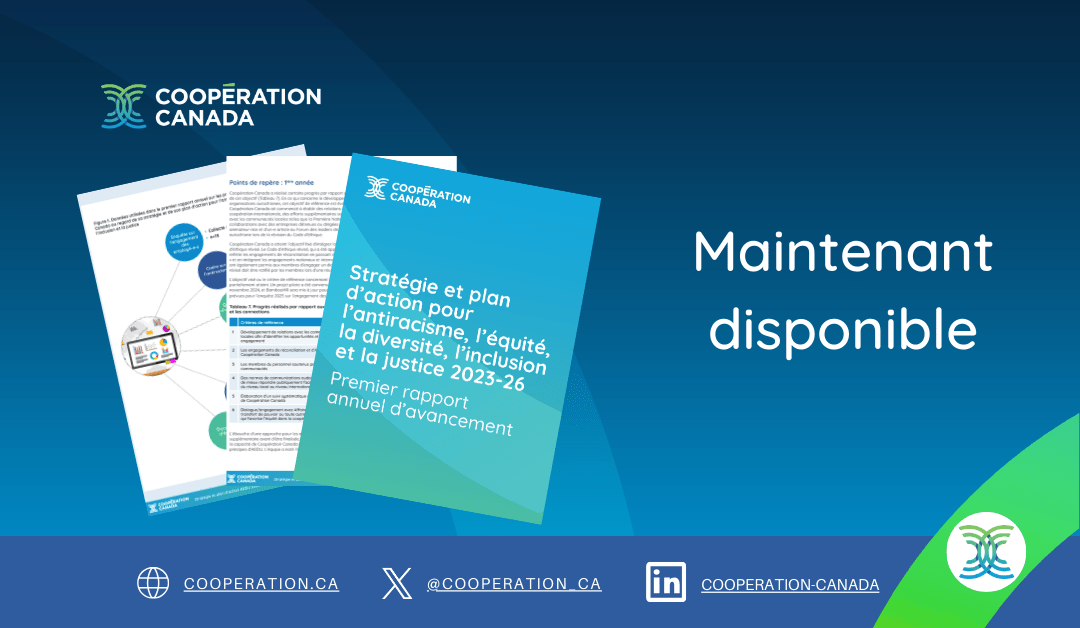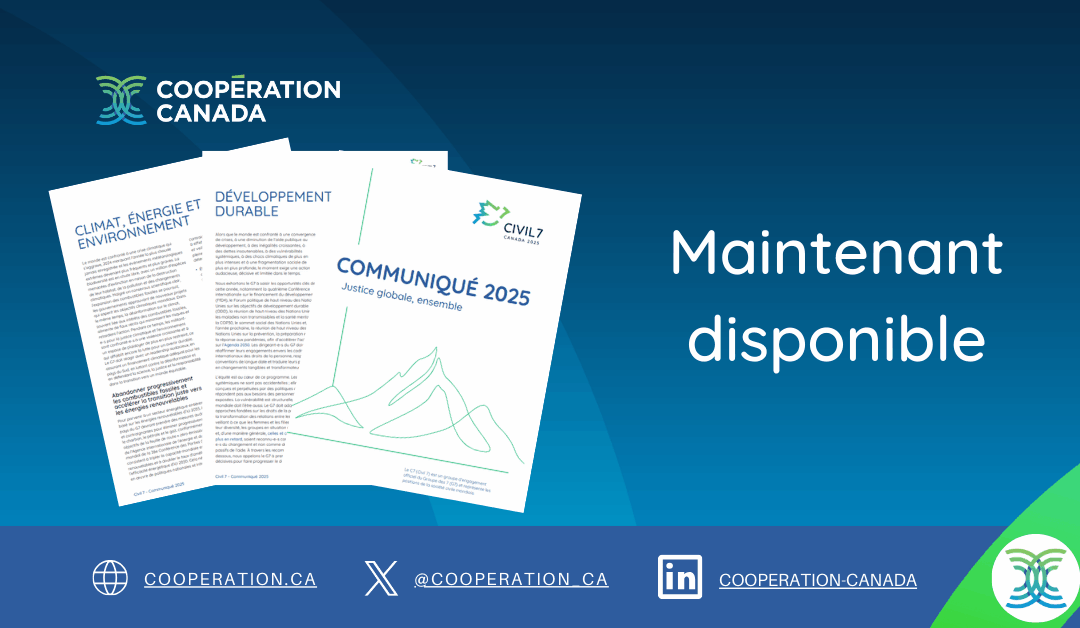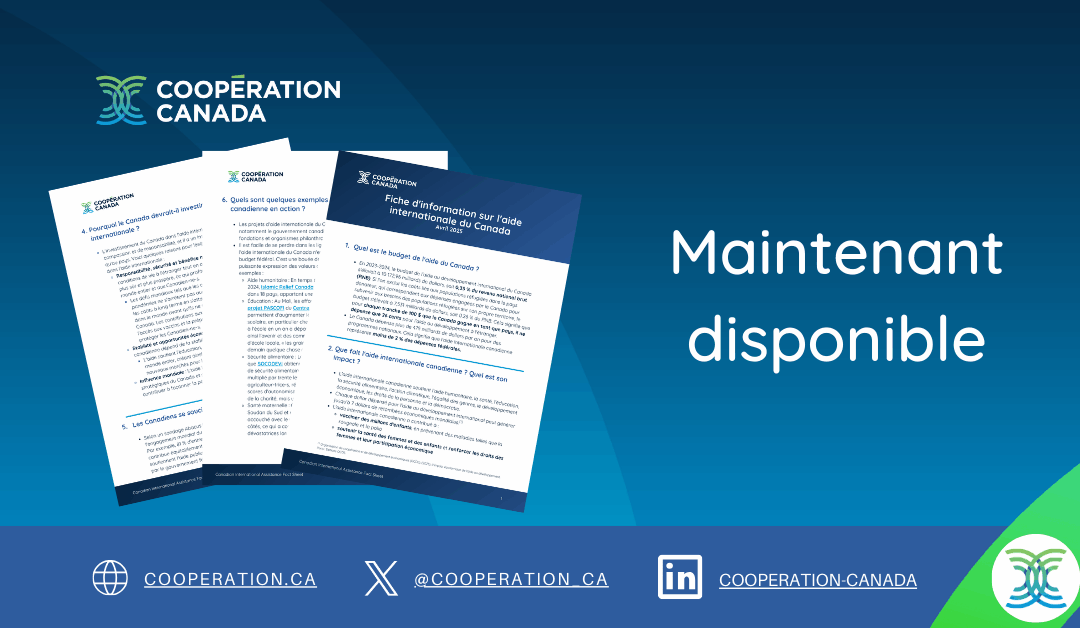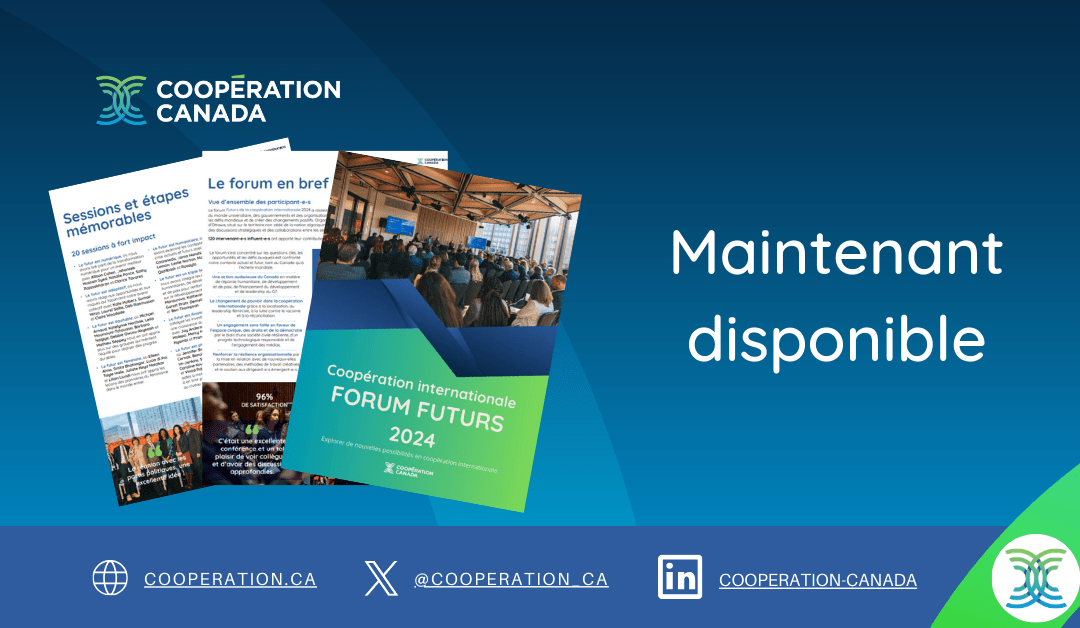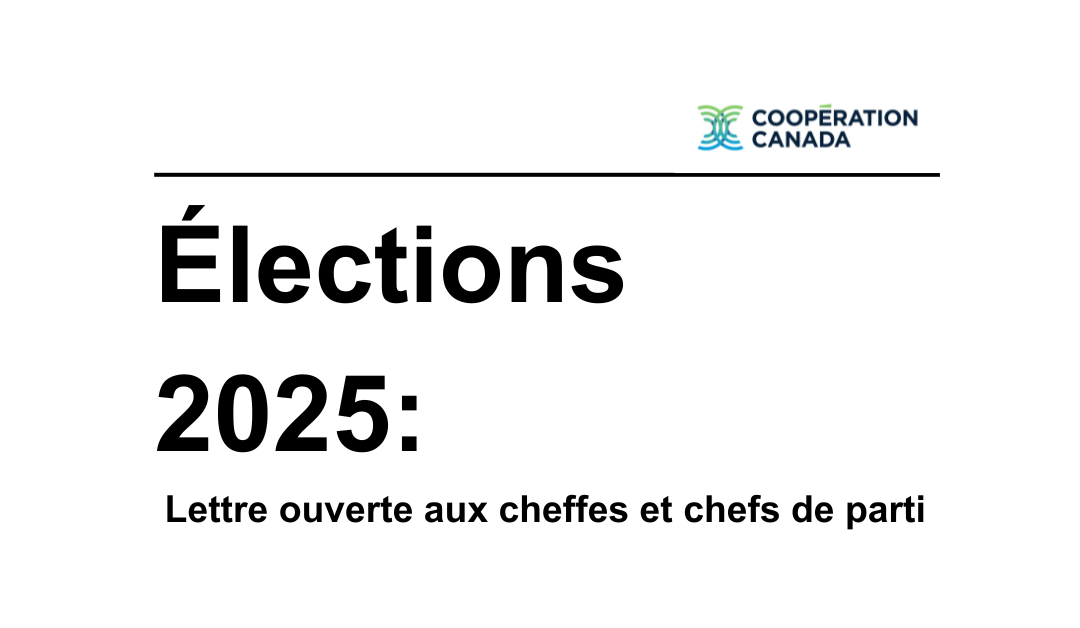Chères cheffes et chers chefs de parti,
Alors que le Canada entre dans la période électorale fédérale, il est clair que les préoccupations économiques, en particulier la menace des droits de douane américains et l’incertitude financière plus large, domineront la conversation. Ces défis sont réels et urgents. Cependant, ils ne peuvent se faire au détriment d’une discussion sérieuse sur la politique étrangère du Canada et son engagement dans le monde.
Les Canadiennes et les Canadiens défendent depuis longtemps la solidarité mondiale et les droits de la personne, non seulement en tant qu’idéaux, mais aussi en tant qu’éléments essentiels à notre propre sécurité, à notre économie et à notre position mondiale. Un monde stable et prospère profite au Canada.
Lorsque vous présenterez vos programmes respectifs lors de cette élection fédérale, les électrices et les électeurs du Canada s’attendent a une vision claire de la manière dont le Canada défendra ces valeurs en 2025 et au-delà.
Les besoins humanitaires ont augmenté. En 2025, plus de 300 millions de personnes dans le monde auront besoin d’une aide humanitaire et d’une protection urgentes. Ce chiffre sans précédent reflète l’escalade des conflits, les catastrophes lieés au climat et l’instabilité économique qui affectent les populations vulnérables dans le monde entier. Les droits de la personne et la démocratie sont menacées partout sur la planète. Le Canada doit agir. L’inaction d’aujourd’hui coûtera bien plus cher que l’engagement et la prévention soutenues de demain.
Le Canada a déjà fait preuve de leadership en temps de crise. Nous devons le faire à nouveau.
Soutenir celles et ceux qui sont dans le besoin n’est pas seulement un impératif moral. C’est un investissement dans la stabilité mondiale, la sécurité et notre avenir collectif. lnvestir dans la santé mondiale contribue a prévenir la propagation des maladies infectieuses. lnvestir dans le développement économique ouvre de nouveaux marchés aux entreprises canadiennes, ce qui stimule la creation d’emplois au pays.
Cheffes et chefs de parti, investir dans un Canada fort et engagé sur la scène mondiale n’est pas seulement la bonne chose à faire, c’est aussi dans notre intérêt.
Le prochain gouvernement ne manquera pas de défis à relever, qu’il s’agisse de s’attaquer aux crises du logement et du coût de la vie au pays ou de gérer une relation précaire avec les ÉtatsUnis. Ces priorités sont urgentes. Mais se retirer du monde serait une erreur de jugement à courte vue, contraire aux intérêts nationaux du Canada. Le moment est venu pour le Canada d’investir dans des partenariats variés et diversifiés avec des pays du monde entier.
Coopération Canada et nos membres s’engagent à travailler avec vous à l’élaboration d’une politique étrangère forte et fondée sur des valeurs qui défend les droits de la personne et la dignité, renforce la stabilité mondiale et assure notre avenir collectif. Nous sommes prêtes à offrir des perspectives et des idées sur la manière dont le Canada peut s’engager et s’impliquer, y compris dans la coopération internationale, dans un ordre mondial fortement perturbé. Comme tout système, la coopération internationale doit évoluer, et nous sommes prêt-e-s à travailler avec vous pour prendre part à ce changement.
Lorsque vous partagerez vos plateformes, nous vous invitons a présenter une vision claire et stratégique de l’engagement du Canada dans le monde. Les Canadiennes et les Canadiens méritent de savoir comment leur pays s’engagera dans le monde d’une manière qui reflète nos valeurs, respecte nos engagements, profite à notre pays et assure notre leadership mondial.
Cordialement,
Kate Higgins
Directrice générale de Coopération Canada