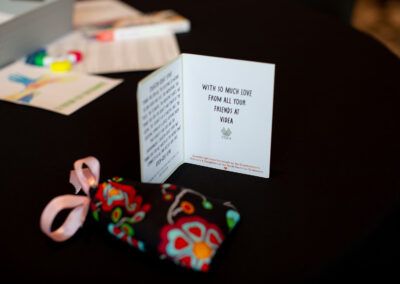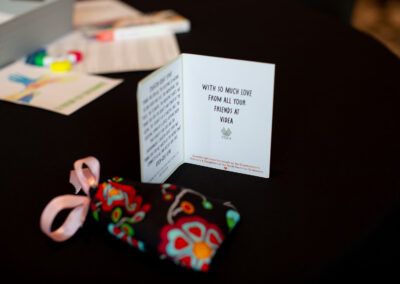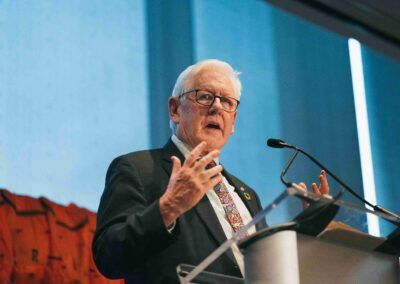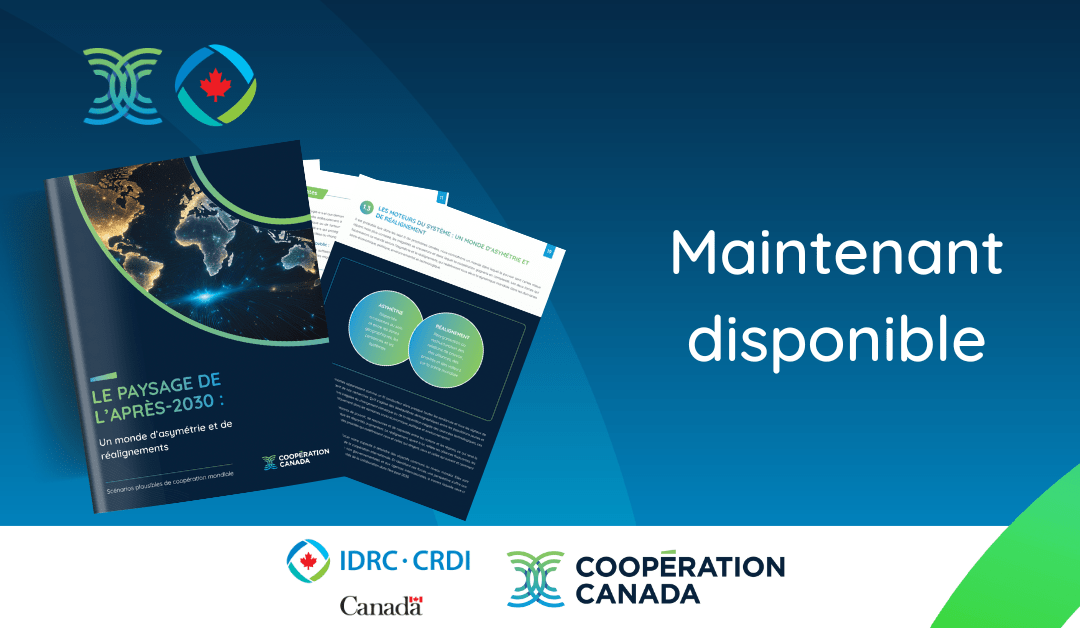Entretien avec Marie-Lisa Dacaney, présidente de l’Institut pour l’entrepreneuriat social en Asie
À une époque où les défis mondiaux deviennent de plus en plus complexes et interconnectés, les modèles traditionnels de développement et de coopération évoluent. C’est la conviction qui sous-tend notre Analyse du paysage mondial du secteur de la coopération internationale, un rapport qui met en lumière les tendances émergentes et les transformations en cours dans le domaine de la coopération mondiale.
L’une des tendances les plus prometteuses dans ce domaine, qui s’appuie sur les conclusions de notre rapport, est la montée en puissance de l’entrepreneuriat social. Défini par sa double mission de durabilité financière et d’impact social, l’entrepreneuriat social est en train de remodeler la façon dont nous envisageons de résoudre les problèmes les plus urgents du monde.
Pour approfondir cette nouvelle tendance, Andy Ouedraogo, agente de recherche et de programme de Coopération Canada, s’entretient avec Marie-Lisa Dacanay, présidente de l’Institut pour l’entrepreneuriat social en Asie. Marie-Lisa, qui siège également au Comité consultatif stratégique de l’Initiative Futus de la coopération mondiale, dirigée par Coopération Canada et financée par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI), apporte un éclairage précieux sur le sujet.
Quelle est l’importance de l’entrepreneuriat social pour la coopération mondiale au développement et quelle est l’ampleur de cette tendance ?
Le rapport Global State of Social Enterprise (avril 2024) estime à 10 millions le nombre d’entreprises sociales dans le monde, générant 2 000 milliards de dollars par an et créant 200 millions d’emplois, soit environ 3 % des entreprises au niveau mondial. En Asie, les entreprises sociales représentent une part plus importante, comme aux Philippines, où elles constituent plus de 15 % des entreprises. Les entreprises sociales contribuent à la réalisation de tous les objectifs de développement durable, notamment en réduisant la pauvreté et les inégalités. Notamment, la moitié d’entre elles sont dirigées par des femmes, contre seulement une entreprise conventionnelle sur cinq. Ces entreprises sont essentielles à l’autonomisation des femmes dans l’agriculture et l’économie informelle, où elles sont traditionnellement invisibles et exclues. L’entrepreneuriat social joue un rôle clé dans le développement mondial, en transformant la vie et les moyens de subsistance des personnes marginalisées.
Quels sont les principaux exemples de réussite d’initiatives d’entrepreneuriat social en Asie qui contribuent aux résultats du développement ?
La Grameen Bank a été la pionnière de la microfinance et a favorisé l’inclusion financière à l’échelle mondiale. Toutefois, des exemples de réussite moins connus inspirent également les plateformes d’entrepreneuriat social en Asie. En partenariat avec l’Association of Progressive Communications (APC), l’ISEA dirige une plateforme axée sur les innovations technologiques pour le développement durable. Cette plateforme promeut des initiatives de connectivité centrées sur la communauté, qui agissent comme des entreprises sociales dans le secteur des TIC, dans le but de réduire la fracture numérique et de connecter les communautés mal desservies dans toute la région.
Une initiative de connectivité communautaire
La Common Room Networks Foundation, le gouvernement du village de Kasepuhan Ciptagelar et Awinet ISP ont lancé une infrastructure internet communautaire qui connectera 43 hameaux et 3 700 personnes d’ici 2024. Soutenue par APC, l’initiative a permis d’augmenter l’utilisation de l’internet par les femmes de 30% à 50%, de soutenir l’éducation à distance et la préparation aux catastrophes pendant la COVID-19. Elle a également subventionné l’internet pour huit écoles, créé des emplois et encouragé le développement de compétences numériques locales, permettant à la communauté de maintenir et d’étendre ses activités tout en utilisant l’internet pour améliorer ses moyens de subsistance.
Partenariats transformationnels et autonomisation économique des femmes dans les chaînes de valeur agricoles
L’ISEA coorganise la plateforme « Autonomisation des femmes, moyens de subsistance et alimentation », qui promeut des critères de référence et des lignes directrices pour les partenariats transformationnels dans les chaînes de valeur agricoles. Ces normes, basées sur les meilleures pratiques des entreprises sociales d’Asie du Sud-Est, améliorent les moyens de subsistance des petit-e-s producteur-trice-s et renforcent l’autonomie des femmes. Les lignes directrices proposent aux gouvernements des politiques visant à soutenir ces critères dans les chaînes de valeur agricoles.
L’initiative Alter Trade
L’initiative Alter Trade est un modèle d’autonomisation qui a permis à quelque 800 travailleur-euse-s agricoles, hommes et femmes, bénéficiaires de la réforme agraire dans les plantations de sucre, de devenir des agriculteur-trice-s-entrepreneur-euse-s, des dirigeant-e-s et des membres de coopératives qui, au fil du temps, ont diversifié leurs cultures et leurs sources de revenus, augmenté leurs actifs et leurs capacités afin d’améliorer leurs moyens de subsistance et de sortir la majorité de leurs ménages de la pauvreté.
L’initiative Bote Central et PCA
Cette initiative a permis à plus de 5 000 agriculteur-trice-s, femmes et jeunes, de s’engager dans la production durable de café et de créer plus de 50 entreprises de café communautaires. Grâce au programme « Coffee for Life » de la PCA, ils ont développé et commercialisé leurs propres marques, bénéficiant ainsi d’une plus grande part de la richesse de la chaîne de valeur du café.
Comment voyez-vous l’entrepreneuriat social façonner le paysage futur de la coopération mondiale au développement, et quels sont les défis ou les obstacles auxquels les entrepreneur-euse-s sociaux-ales sont confronté-e-s pour conduire des changements positifs ?
Le rapport 2023 sur les ODD souligne que 85 % des Objectifs de développement durable (ODD) ne sont pas sur la bonne voie, stagnent ou régressent, ce qui met l’Agenda 2030 en péril. L’entrepreneuriat social pourrait être une stratégie clé pour accélérer les progrès, mais son potentiel reste méconnu par de nombreux gouvernements, en particulier dans les pays en développement. La coopération mondiale au développement peut jouer un rôle essentiel dans l’élargissement de l’impact des entreprises sociales en relevant des défis tels que le financement inadéquat et le manque de politiques de soutien.
Une approche à deux volets est proposée : premièrement, un investissement direct dans les entreprises sociales afin d’étendre et de reproduire les initiatives réussies, et deuxièmement, un partenariat avec les gouvernements engagés afin de créer des politiques et des programmes qui soutiennent et encouragent le secteur. L’Asie, avec ses plateformes multipartites existantes et l’intérêt d’agences telles que la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique, pourrait servir de région pilote pour cette initiative mondiale de coopération au développement, en aidant à intégrer l’entrepreneuriat social en tant que stratégie de transformation pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement.
Alors que l’entrepreneuriat social continue de gagner du terrain, son potentiel pour remodeler la coopération mondiale au développement est indéniable. En s’attaquant aux problèmes systémiques et en donnant aux communautés marginalisées les moyens d’agir, il offre une voie de transformation. Cependant, pour libérer pleinement son impact, les gouvernements, les organisations de développement et les acteur-trice-s du secteur privé doivent travailler ensemble pour créer des environnements favorables et développer des initiatives réussies. L’avenir de la coopération mondiale pourrait bien dépendre de l’adoption de ces approches novatrices pour relever les défis mondiaux les plus pressants.